Recherche
Chroniques
Claudio Abbado et les Berliner Philharmoniker
Moussorgski – Stravinsky – Tchaïkovski
Le 14 octobre 1994, dans l’enceinte du Suntory Hall (Tokyo), les caméras de la NHK saisissent un concert des Berliner Philharmoniker, formation précise dans les interventions collectives comme individuelles. À leur tête, Claudio Abbado (1933-2014), le chef milanais qui, élevé dans une famille musicienne, reconnaît l’influence de Debussy puis de Furtwängler sur son éducation artistique. Cette imprégnation européenne l’a d’ailleurs incité à revenir vers le Vieux Continent, alors que les États-Unis souhaitaient le retenir, en la personne de Bernstein, au début des années soixante. Paradoxalement, près de trois décennies plus tard, il vise un engagement à Chicago puis New York quand la mort de Karajan, en juillet 1989, lui ouvre les portes de l’Orchestre Philharmonique de Berlin. Une nouvelle ère commence, à l’image du concert inaugural invitant son contemporain Rihm entre Mahler et Schubert.
Ce programme russe d’une heure et demie s’ouvre avec Modeste Moussorgski (1839-1881), pilier du Groupe des Cinq qui détestait l’approche européenne de Tchaïkovski et Rubinstein. Avec des œuvres comme Boris Godounov, ou l’inachevée Foire de Sorotchintsy [lire notre chronique du 22 avril 2017], le natif de Karevo célèbre les racines folkloriques, lesquelles sont aussi vivaces dans Une nuit sur le mont chauve. Inspiré par une nouvelle de Gogol, le poème symphonique achevé à l’été 1867 possède plusieurs versions, dont une troisième réorchestrée par l’auteur de Mlada [lire notre critique du DVD]. Mais l’on peine à retrouver sorcières et divinité ténébreuse dans cette version policée, si bien que d’aucuns reviennent, tel Abbado, à l’âpreté de l’original – rappelons d’ailleurs que, par souci de fidélité, ce partisan de Moussorgski avait déjà renoncé à Rimski-Korsakov, et choisi Chostakovitch, au moment de jouer l’opéra Khovantchina [lire notre critique du DVD]. Le maestro excelle à faire entendre les éléments (feu, vent) dans cette partition au mystère veiné d’orientalisme.
Inspiré par un conte national, L’oiseau de feu possède également trois versions, écrites entre 1910 et 1945. Plutôt que la première, créée à Paris sous la baguette de Pierné, et l’ultime, défendue à New York conduite par Horenstein, Abbado interprète la suite qu’Igor Stravinsky (1882-1971) tire de son ballet en 1919, à destination d’un orchestre réduit. Cinq mouvements concentrent désormais les dix-neuf numéros dédiés à Rimski-Korsakov, professeur estimé dont Le coq d’or (1909) fut alors une influence majeure pour l’élève mis en garde contre le Conservatoire. On apprécie particulièrement la nuance mezzo-piano, assez durable, avec laquelle le chef italien installe le secret de l’introduction, ainsi que le lyrisme de parties plus rythmées.
Le concert s’achève avec la Symphonie en ré mineur Op.64 n°5. Piotr Tchaïkovski (1840-1893) s’y attelle entre mai et août 1888, au faîte de sa gloire. Pourtant la création à Saint-Pétersbourg, le 17 novembre, n’enflamme que le public, la critique dénonçant, entre autres, le manque de fougue slave. Dès lors, le musicien avoue son œuvre « trop confuse, trop compacte, manquant de sincérité », ainsi qu’il l’écrit à sa bienfaitrice, Nadejda von Meck. Cependant, elle marque l’esprit par son thème cyclique, présent dans chacun des quatre mouvements, symbole d’une « soumission totale devant le destin », ce qu’on nomme Providence. Le premier offre un climat désolé, une incroyable gravité, où le courage et la dignité accompagnent l’effacement progressif des ombres. Tour à tour poignant et caressant, le suivant mène à l’avant-dernier, élégant, délicat et entrainant. Enfin, l’ultime portion jouit d’une tonicité flamboyante, où éclate la modernité du futur créateur de La dame de pique (1890) [lire notre critique du CD et du DVD].
LB

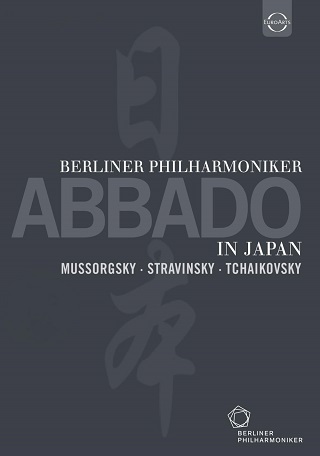
 Email
Email
 Imprimer
Imprimer
 Twitter
Twitter
 Facebook
Facebook
 Myspace
Myspace