Recherche
Chroniques
Othmar Schoeck
Das Schloß Dürande | Le château de Durande
Avec le motif de la rose, dont il est question de faire perdurer la tradition dans un monde qui met en conflit l’antan et l’aujourd’hui, apparaît une délicatesse sonore qui tient du prodige. Lorsque Der Rosenkavalier est créé, en 1911, Richard Strauss travaille déjà au chef-d’œuvre qui verrait le jour en 1919, Die Frau ohne Schatten, et ce n’est pas un hasard si le miracle des timbres, inventé dans l’aîné de ces deux opus, s’accomplit dans le cadet. Entre volonté de dépassement du modèle wagnérien et fascination pour ce pur cristal straussien, la génération qui suit invitait également la symphonie mahlérienne à l’opéra. S’il n’en fallait considérer qu’un seul exemple, ce serait Franz Schreker, assurément, dont le son lointain hante la production, tant dans Der ferne Klang (1912) que dans Die Gezeichneten (1918) ou Die Schatzgräber (1920). Cette tournerie de pampilles est alors le signal du merveilleux – musique jamais entendue qu’un compositeur inspiré tente en vain d’entendre et de coucher sur la page, miroitement des fêtes mystérieuses sur l’île Élysée et scintillement du luth enchanté d’Elis [lire nos chroniques du 19 avril 2019, du 18 avril 2004, du 27 avril 2013, du 17 mars 2015, du 7 juillet 2017, du 7 mars 2004 et du 15 septembre 2012].
Un peu plus d’une décennie plus tard, on retrouve cet élément particulier dans Das Schloß Dürande, attaché en particulier au personnage de Gabriele, la jeune fille dont la flottaison vocale semble toujours surgie d’un rêve : Othmar Schoeck use de ce carillon magique comme d’un sésame vers l’onirique, marque de fabrique, si l’on peut dire, à peine dévoyée dans l’isolement bienheureux de l’amour. En adaptant à la scène lyrique le bref roman éponyme de Joseph von Eichendorff, publié un siècle auparavant (Friedrich Arnold Brockhaus Verlag, 1836 ; version française d’Armel Guerne, Éditions Desclée de Brouwer, 1956), le compositeur suisse (1886-1956) magnifie cette mystique de ceux qui s’aiment, par-delà les luttes révolutionnaires de la France à la fin du XVIIIe siècle et l’égarement d’un bourgeois, traître à la noblesse qui l’emploie et traître au peuple qu’il manipule à des fins privées : la farouche défense de l’honneur de sa sœur.
Une équipe vocale d’une tenue exemplaire, dont chaque membre a été idéalement distribué (y compris dans les petits rôles) est au service de la présente résurrection de l’ultime opéra de Schoeck. Réalisé au Stadttheater de Berne le 2 juin 2018, cet enregistrement qui fait mouche est une prise live que l’on salue avec enthousiasme, tant il est rare de conjuguer de si belles qualités sans le filet du travail en studio. Michael Feyfar (ténor) prête ce qu’il faut de fermeté à l’Orateur public et de velours au Jardinier. Nazariy Sadivskyy (ténor) use de souplesse et de légèreté pour incarner l’Avocat, d’un timbre qui en transmet parfaitement la malignité, en complice avisé de l’accompagnement orchestral. L’inflexion noble, la couleur généreuse et la puissance d’Hilke Andersen (mezzo-soprano) confèrent à la Prieure une autorité naturelle. D’un instrument solide, Todd Boyce (baryton) campe aussi bien le Garde-chasse que Buffon, l’aubergiste parisien : saine, la ligne vocale prend appui sur un grain robuste [lire notre chronique de Lotario]. Plusieurs fois applaudie à Mannheim [lire nos chroniques du Joueur et d’Hercule], Ludovica Bello (mezzo-soprano) possède le lustre intense qui convient à la comtesse Morvaille, bouleversante à l’Acte IV. Quant au Nicolas de Jordan Shanahan (baryton-basse), le vieux majordome fidèle et toujours fort humain se révèle lui aussi au dernier temps de l’opéra, par une poigne que ne laissaient pas supposer les premières mesures.
Le quatuor de tête n’est pas en reste, loin s’en faut ! En rupture avec le stéréotype vocal selon lequel les pères sont forcément des basses, Othmar Schoeck a confié le Vieux Comte à un ténor : d’une inflexion précieuse, Andries Cloete endosse aisément la peau de ce personnage d’abord un peu ridicule puis pathétique par son enfermement dans l’éternel autrefois féodal. La ligne onirique de Gabriele, écrite dans un ailleurs ayant quasi-fonction de visitation, nous vient ici de Sophie Gordeladze (soprano), dotée de la fraîcheur nécessaire. On retrouve le vaillant Robin Adams [lire nos chroniques des Bassarids et de Quartett], belliqueux à souhait en Renald, noir vengeur aveuglé par la passion, jusqu’au crime. Son rival – le terme s’impose face à la rage souterrainement incestueuse des frères qui jalousement veillent au pucelage de leur sœur, éloquente idée fixe… – n’est autre que le très doux Uwe Stickert (ténor), Armand de Durande tendre dont séduit immanquablement la saine clarté : déjà remarquées par le passé, l’élégance du chant et la pureté d’inflexion l’investissent des ailes de l’ange [lire nos chroniques des Meistersinger von Nürnberg et Die Soldaten].
Ardent champion de la musique de Schoeck [lire nos chroniques de Penthesilea et de l’Œuvre chorale], l’excellent Mario Venzago signe non seulement une lecture orchestrale infiniment nuancée et dramatique en diable, forte d’un équilibre soignée entre voix et fosse comme entre les pupitres du Berner Sinfonieorchester, mais l’adaptation elle-même puisque Das Schloß Dürande fit l’objet d’une révision avant le concert bernois de 2018. En effet, la pénible inscription du livret original d’Hermann Burte dans l’idéologie nazie, en vue de la création à Berlin en avril 1943, ainsi que ses nombreux vers de mirliton exigeaient qu’on y remît la main : l’écrivain suisse d’origine calabraise Francesco Micieli s’en est chargé, respectueux de l’hyperlyrisme caractéristique du romantisme tardif qu’il sut reconstituer, comme de la prose ardente d’Eichendorff. Dans le même esprit, Venzago s’est penché sur la partition, sachant qu’elle avait été presque entièrement écrite avant que le compositeur eût connaissance du livret : les ajouts postérieurs semblent si évidents que les coupures s’imposaient d’elles-mêmes. Outre la grande exigence artistique de cette gravure, elle offre donc un travail de nettoyage et de réhabilitation. Saluons enfin les artistes du Konzert Theater Bern, dûment préparés par Zsolt Czetner. À découvrir !
BB

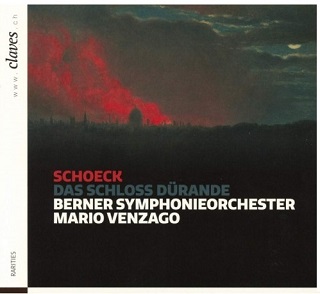
 Email
Email
 Imprimer
Imprimer
 Twitter
Twitter
 Facebook
Facebook
 Myspace
Myspace